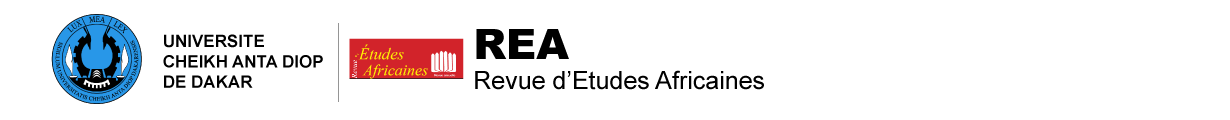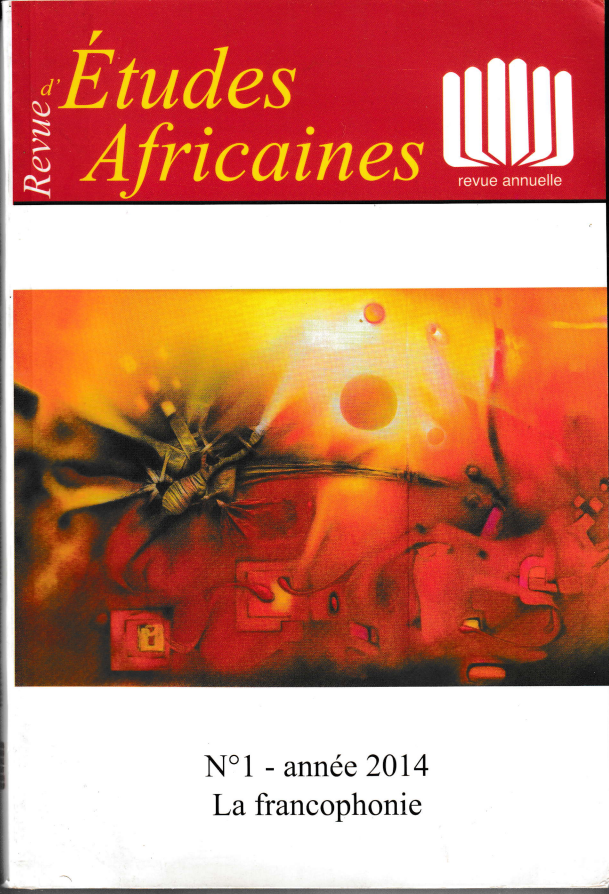De L’universalisation De La Langue Française À L’allocentrisme Dans Le Discours De Nicolas Sarkozy À L’occasion Du 40ème Anniversaire De La Francophonie
DOI :
https://doi.org/10.61585/pud-rea-v1n103Résumé
Dans son ouvrage intitulé France, Algérie et colonies2, Onésime Reclus a inventé les mots francophone et francophonie. Ces néologismes à forte coloration colonialiste ont sombré dans l’oubli en même temps que leur créateur pendant près d’un siècle. On préférait cependant utiliser les circonlocutions : « de langue française », « d’expression française », « partiellement ou entièrement de langue française » jusqu’à ce que les journalistes et les hommes politiques remettent ces termes au goût du jour après le premier Sommet de l’organisation correspondante à Paris en 1986. Ainsi, la première définition de la « francophonie » est l’œuvre d’Onésime Reclus, frère du célèbre géographe Élisée Reclus. Géographe comme son frère, il voulait regrouper sous ce terme l’ensemble des pays et des populations qui utilisent à un titre ou à un autre la langue française. Toutefois, le poète et homme politique sénégalais Léopold Sedar Senghor préférait utiliser le terme « francité ». Par « francité », il fallait alors entendre « l’ensemble des caractères propres à la civilisation française »3. Mais en 1962, la Revue Esprit, publiant un numéro devenu référence aujourd’hui, cite de nouveau le mot « francophonie ». Ce concept recevait dès lors une consécration irrévocable qui reléguait définitivement au second rang les termes tels que « francitude », « francité », « communauté francophone », « communauté de langue française », etc. Au regard des ressortissants du tiers monde, la francophonie n’a pas entièrement perdu ses présupposés idéologiques. Plusieurs, à l’instar de Guy Ossito Midiohouan, continuent d’y voir « le bras armé de la France »4. La francophonie est, de ce point de vue, un aspect important de la politique culturelle de la France et même de sa politique tout court. Elle est d’abord et avant toute chose une affaire des femmes et des hommes qui partagent une langue commune : le français. Ainsi, dès les premières décennies du XXe siècle, des francophones ont pris conscience de l’existence d’un espace linguistique partagé, convenable aux échanges et à l’enrichissement réciproque. Dès lors, nous voudrions étudier l’universalisation de la langue française et surtout la tendance altruiste et charitable de ce mondialisme à travers le prisme de la francophonie dans le discours que Nicolas Sarkozy a prononcé le 20 mars 2010 à l’occasion du 40e anniversaire de la francophonie. Nous vérifierons si la mondialisation du français fait de cette langue un véritable vecteur des échanges.